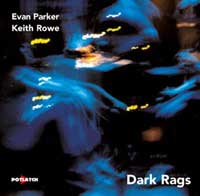2.gif) |
texte
de pochette |
|
|
| Tout
au long des années de folle libération des mœurs
musicales de la “swinging London” des sixties,
les groupes pop n’étaient pas les seuls à tenir
le haut du pavé de la créativité et de l’invention.
Une poignée de jeunes musiciens — généralement
issus des cercles du (free) jazz noir américain et souvent
attirés par l’aléatoire, l’atonalité
ou le sérialisme — allaient faire table rase du passé
et s’engager dans une remise en cause radicale du geste musical
à l’intérieur de groupes à l’importance
historique forte, tels que AMM et le Spontaneous Music Ensemble.
Visiteur assidu du Little Theatre Club à Londres en 1966,
le saxophoniste Evan Parker se trouve vite invité par le
batteur John Stevens à participer au Spontaneous Music Ensemble,
qui développe une forme d’improvisation délicate
et aérée, aux mouvements abstraits généralement
lents et calmes, où les contributions individuelles passent
derrière la construction collective.
Parker entame alors une longue et fructueuse collaboration avec
le guitariste Derek Bailey — interrompue en 1985 —, se
produisant avec lui en duo, au sein de la Music Improvisation Company.
Parallèlement, il est amené à fréquenter
les cercles du robuste free jazz allemand (aux cotés de Peter
Brötzmann, au sein du trio d’Alex von Schlippenbach, du
Globe Unity Orchestra, etc.), basé sur l'énergie et
la puissance.
Prolongeant avec force l’héritage coltranien, il conçoit
alors de manière intuitive — afin de pouvoir répondre
efficacement aux stimuli de ses partenaires — diverses combinaisons
saisissantes de “techniques étendues” sur le plan
de l’articulation, de l’attaque, de certains doigtés
“fourchus” brisant la colonne d’air et déployant
des structures mouvantes d’harmoniques, de la respiration continue
(d’abord au soprano, puis plus récemment au ténor),
créant ainsi une resplendissante “illusion de polyphonie”
au saxophone.
Tout en poursuivant des études d’arts plastiques, Keith
Rowe commence à jouer de la guitare au sein de l’orchestre
de l’école des beaux-arts de Plymouth (qui deviendra
plus tard le Mike Westbrook Band) et participe à la création
du groupe AMM — les premiers, en 1965, à abandonner
l’idée d’une musique basée sur le répertoire
— avec Eddie Prévost et Lou Gare (vite rejoints par
Cornelius Cardew, puis par Christopher Hobbs et/ou John Tilbury
et Rohan de Saram). Au milieu de connexions explicites avec le jazz
et la musique académique, AMM repense radicalement les notions
de son et de production musicale en inventant une musique venue
de nulle part et coupée de toute allégeance, à
travers tout un train de techniques non orthodoxes, d’instruments
détournés ou fabriqués, dans une improvisation
ouverte à toutes les sources sonores, sans distinction entre
“les sons choisis et les sons accidentels” (Cage).
S’inspirant à la fois de musiciens (noirs américains)
et de peintres (Duchamp, Pollock, Rauschenberg…), Keith Rowe
va complètement déstabiliser la guitare en lui imposant
une réévaluation profonde, abandonnant certains de
ses éléments traditionnels, comme l’accord ou
la relation entre les cordes et les doigts, en en jouant à
plat sur une table et la manipulant avec des archets, des tiges
de métal, des ressorts ou une radio à transistors,
déployant ainsi une “une virtuosité modeste
dont l’aboutissement est le simple son” (Christian
Wolff).
Se croisant et s’appréciant depuis les mid-sixties (Parker
fut l’un des très rares solistes invités par
AMM), il aura fallu attendre près de trente-cinq ans pour
que Evan Parker et Keith Rowe se produisent pour la première
fois en duo, aux Instants chavirés à Montreuil en
décembre 1998. Dark Rags est le premier témoignage
discographique de la complicité nue de ces deux ardents pionniers.
Ici, pas d’étalage de virtuosité ni d’épreuve
de force, mais un univers onirique de sons crus et neufs, libérés
du poids historique de la tradition, un foisonnement de couleurs
éclatées et de textures brutes. Ensemble, ils créent
une mosaïque de micro-sons et de scories, une jungle de souffles
et de plaintes grouillant et se répondant dans une vertigineuse
surimpression de nappes longues et bariolées superbement
en prise avec le présent.
Gérard
Rouy
|
2.gif) |
liner
notes |
|
|
| DARK
RAGS (DARKER RAGAS)
What,
one wonders, must it be like to hear Parker and Rowe for the first
time? None too likely an occurrence, however, given their 35-year
involvement in the music, Rowe an early and continuing member of
AMM, Parker a long-time front-line GB (1)
(and one of the few saxophonists to pick up the soprano without
provoking the listener to rue the day that horn was straightened
out).
The rags at hand have added a fourth to the raga’s three acknowledged
sources : mathematics, astronomy, and psychology – that of
autopsy (2), a process by
which it is confirmed that the capacities of ears, as those of hearts,
are not the same in all of us.
Keith Rowe was one of the first flat, as opposed to slack, object
guitarists to measure these capacities, initially with the AMM and
drummer-percussionist Eddie Prévost, and currently with John
Tilbury, whose recent work includes recordings of Morton Feldman
compositions.
The language of each of these players, as with Hindi and Urdu, is
almost the same when spoken (played), but different when written
(heard).
The duo of Parker and Rowe succeeds in eliminating what other duos
strive to simplify. (As in disjunct adjunct ; adjunct
disjunct.) Each of these two performances in Nantes on the last
Friday of 1999 contains a multiplicity of divisions. (As in out
of tempo and in no known tempo.) Such divisions of extremely brief
duration reveal an application from raga to rag of the Scruti
Truth Sutra, with the duo providing lilting reminders that sound
invents.
There is no need to listen here as though monitoring; provisions
have been made for you to listen creatively, free of clinging past
listening, free of the onerous chores of accumulation. (“Experience
a form of paralysis (3).”)
Parker and Rowe undertake instantaneous conversions of self-inflicted
impediments encountered en route, from first shared note
to last, freeing their instruments and themselves from the huffishly
sere mannerisms of free (4)
in an undertaking wherein a vast compendious inventory of undiscovered
sounds is knowingly rummaged through. Even those sounds potentially
recalcitrant are brought forth, while bypassing lesser, mouldering
sounds-in-waiting (for the arrival, ledger and score in hand, of
the next faux improviser). These sounds move between Parker
and Rowe from nightposts to barrel rungs to flat rocks to the surface
of harbour, and to those long folds of uncut toweling strategically
dispersed amid the bogus silences of seminaries.
Products of guitar dissection are deposited in tuned brass bowls
and ceramic cups no larger than required to wash an eye, with no
notes being employed to make up a large crowd in a small space.
Evan Parker has a way of easing phrases into causes so unplanned
that their effects extend into further causes, the wakes of which
themselves become source to Rowe, and vice versa. You will notice
that not all effects are immediate effects, and that the calling
up here of long-ago echoes of sounds in slow streaming is far from
wearying - it’s riveting. And as timeless and as weightless
as bugs on water.
Just plain unpronounceable sounds occasionally require bending if
not splitting, or welding to a neighbouring sound, as is unpredictably
the case with perimeter sounds still cutting their milkteeth, and
those sullen sounds too self-enchanted to float into relinquishment
rather than into mere devices of continuity.
This music is an abundance of beautiful moments.
Paul
Haines
l June
2000
(1)
GB : Global Dispenser.
(2) More conventionally known as metonym
for melodic probe, i.e., grabbing the sphinx by the balls.
(3) Erik Satie.
(4) Dieu – comme on le nomme vulgairement
– sait que tout le monde en a marre du manque général
d'improvisation dans le jazz aride d’aujourd'hui.
|
2.gif) |
chroniques |
|
|
| Même
si le saxophoniste fut l’un des très rares musiciens
à avoir été invité par AMM, c’est
la première fois qu’Evan Parker et Keith Rowe enregistraient
ensemble. Ça se passait à Nantes, dans la douceur
ouatée du club Pannonica, pendant la nuit de la St-Sylvestre
2000, où le temps était suspendu. Malgré le
titre de l’album, nous sommes loin de la musique indienne,
même si le programme consiste en deux longues pièces
méditatives plutôt calmes d’une sorte de musique
industrielle où l’on ne discerne souvent que quelques
rumeurs déliquescentes venues de loin. Proche de l’électronique
et d’une certaine esthétique « ambient »
avec sa guitare de table préparée, Rowe crée
des paysages crus où fourmillent d’innombrables textures
hérissées par dessus lesquelles Parker se glisse sans
furie mais avec une vive tension. On se croirait dans une centrale
électrique, une usine métallurgique ou, beaucoup plus
poétique, sur un paquebot de nuit, le nez au vent, la tête
dans les étoiles…
Gérard Rouy
l Jazz Magazine l
Novembre 2006
La
rencontre du flux électrique et du souffle. Ce duo marche
vraiment bien, au premier abord on peut effectivement se dire: il
y a d'un côté Keith Rowe et de l'autre Evan Parker,
ils jouent ensemble sans être complètement ensemble.
Mais le croisement s'opère au fil de l'enregistrement et
la confrontation de deux mondes se change en un échange profond
où l'on se laisse porter par les grains radiophoniques et
la salive brouillasante. Une étrange pâte se dégage
de l'ensemble, une trame de fond tissé par Keith Rowe sur
laquelle Evan Parker apporte ses couieurs formant ainsi une peinture
abstraite faite de forme géométrique, de plusieurs
niveaux de lecture et grappes explosives. Le mouvement est descendant
allant de l'ébruitement, du carrossage un peu sec vers une
étrange plénitude où le flot sonore laisse
présager une marée montante; la rencontre ne se fait
pas sans heurt et sans dommage, ça parle organique, l'acoustique
et l'électrique mais strictement déliées, d'un
côté le saxophone, source très reconnaissable,
un ténor sans doute et de l'autre moins reconnaissable les
cordes, les micros contacts et l'électronique du dispositif
de Keith Rowe. Cette pâte restera toujours présente
tout au long du disque sans jamais se laisser nommer.
Julien Ottavi
l Revue
et Corrigée
l Juillet
2001
Evan Parker est le maître britannique du saxophone expérimental
(ténor et soprano) ; Keith Rowe, anglais lui aussi, est un
guitariste "bruitiste" électronique. Ne pas se
laisser induire en erreur par le titre de leur album: ces "rags"
ne sont pas des ragtimes passés dans une sombre moulinette
free, mais bien des lambeaux de musique qui flottent dans une ombre
propice aux rêveries muettes. Jamais sans doute dans la musique
improvisée on n'aura joué avec autant de délicatesse
du souffle continu, autant de tendresse pour ce qui fait l'essentiel
de la musique: le silence, bien entendu. Comme le dit Paul Haines,
l'écrivain qui accompagne de ses textes depuis plus de quarante
ans quelques disques rares et définitifs, il est devenu exceptionnel
que deux improvisateurs jouent à ce point de la rencontre
pour "libérer leurs instruments et eux-mêmes
des maniérismes du free, flétris jusqu'à la
transparence pour avoir été trop soufflés".
Ici, tout n'est que beautés surprenantes, et l'on croit voir
des chutes bariolées de soieries ou des chiffons de belles
laines mêlés à des scories de métal,
dans une douce lumière d'atelier où brillent des éclats
de son qui caressent plutôt qu'ils n'éveillent l'auditeur
de sa stupeur. Les Instants Chavirés à Montreuil,
Pannonica à Nantes sont les lieux en France où cette
musique est accueillie, appréciée à sa valeur
d'échange somptuaire, et le label Potlatch se voue exclusivement
à ce présent chavirant, enregistré live comme
il se doit pour la musique vivante.
Michel
Contat
l Télérama
l Novembre
2000
Disons
qu'il s'agit bien d'un événement. Evan Parker, saxophoniste
et Keith Rowe, guitariste, figures majeures de la musique britannique
d'une part, européenne d'autre part, ont joué et enregistré
en duo pour la première fois en trente-cinq ans de cheminements
parallèles dans les musiques improvisées et l'expérimentation,
Question de circonstances probablement, mais aussi peut-être
d'une volonté non exprimée de se retrouver au moment
le plus juste, pour répondre à un appel lancé
par la musique. Donc au Pannonica de Nantes excellent endroit -
Parker et Rowe jouent ensemble, sans renoncer aux préoccupations
esthétiques qui sont propres à chacun, sans non plus
transformer l'acte musical instantané en un concours à
l'épate où l'un irait dominer l'autre. Même
si l'on sait suffisamment bien qu'il n'y eut jamais chez eux de
telles dispositions. Sans cri, ni défoulement, ni éclats,
Parker et Rowe exposent leur recherche sur les textures et les timbres,
leur conception ouverte de la mise en espace et, une fois de plus,
leur maîtrise de l'instrument. Un instrument dont la matière
et les mécaniques sont considérées comme un
tout également producteur de sons. Ce dont les deux artistes
démontrent, d'un geste commun, la pertinence. Texte passionné
et érudit de notre camarade Gérard Rouy, très
belle pochette due à Jean-Marc Foussat, par ailleurs l'ingénieur
du son de cet enregistrement d'une grande clarté.
Sylvain Siclier
l Jazzman
l Novembre
2000
Quel plaisir doit-il y avoir à publier de telles œuvres
! Fidèle à son habitude, l'enthousiasmant label Potlatch
vient de sortir deux "pièces" d'un coup; comme
l'hiver dernier (avec le duo Lacy/Bailey, Outcome, P299,
et la rencontre de Xavier Charles avec Kristoff K.Roll, La Pièce,
P199), un disque d'improvisateurs renommés accompagne un
enregistrement d'artistes un peu moins connus; aujourd'hui, Evan
Parker et Keith Rowe, avec leurs Dark Rags, ouvrent la route
au très recommandable duo de Denman Maroney et de Hans Tammen
intitulé Billabong (P100). Les deux Anglais se connaissent
depuis trente-cinq ans et n'ont joué en duo que tout récemment
(relisez l'interview de Rowe par Gérard Rouy publiée
dans nos colonnes), se croisant à maintes reprises dans diverses
configurations; avec ce disque se boucle aussi la série d'enregistrements
en duo de Parker (qui semble bien être le seul musicien a
pouvoir s’insérer dans les fibres de la musique du groupe)
avec les membres d'AMM: Eddie Prévost pour l'étonnant
Most Materiall (Matchless MRCD33, Dist. Metamkine) et John
Tilbury pour Two Chapters and an Epilogue (Matchless MRCD39).
Se prolongent aussi de la sorte les rencontres de Rowe avec les
anches, dont l'excellent Dial: Log-Rhythm (Matchless MRCD36)
avec Jeffrey Morgan. L'entrelacs de références guitaro-saxophonistiques
obliques pourrait continuer... de la paire (jusqu'en 1985) des "compatibles"
Bailey et Parker, à la présence sur le catalogue Potlatch
du duo Lacy/Bailey... Si ces deux derniers peuvent être assimilés
à de grands rhétoriqueurs, Evan et Keith relèvent
plutôt de la famille des chimistes, vendeurs de matière
verbale et tamiseurs d'encre sonore.
Captés lors des festivités nantaises des 31 décembre
et 1er janvier derniers, les deux sets offerts présentent
Parker au seul ténor (quant à ses prestations au soprano,
espérons qu'elles sortent un jour !); son Chicago Solo
(1995, Okka OD12017, Dist. Improjazz) sur cet instrument qu'il réinvestit
avec ardeur depuis quelques temps avait indiqué la voie :
les techniques développées au soprano (telles qu'il
les évoque dans De Motu, cf. notre hors série
d'automne), transposées au ténor, élargissent
le champ d'investigation de ce dernier. Stimulé par les propositions
de Rowe, Parker se voit ici obligé d'inventer de nouveaux
cheminements : point d'emballements de volutes, mais un nécessaire
jeu "sur la brèche" qui étonne, de la fouille
de textures jusqu'aux larges et ondulantes poussées legato.
La métaphore textile que suggèrent les rags (ces
chiffons, guenilles, lambeaux... à moins qu'ils n'évoquent
les blagues, les farces, ou quelque ragtime...) peut
guider : surface et profondeur des draperies de cathédrales
englouties par Rowe, soie sauvage des longues nappes de Parker;
le passionnant continuum sonore, de suspensions en hérissements,
happe sans retour. Trames froissées ou hachures repesées,
escarbilles filantes ou fleuves métalliques (guitare réactive
toujours fissile et sax entre jardin de pierres ratissé et
écroulements de séracs), outre-dark les matériaux
s'inventent dans une complicité qui se vit à une altitude
de perception ébahissante. La musique semble demander qu'on
invente une nouvelle manière de l’écouter. En
audition flottante mais disponible, euphorie et stupéfaction
vous guettent ! En écoute acérée, fractales
et mondes surimprimés fascinent avec une étrange sérénité
!
Une mention particulière enfin à la qualité
du livret d'accompagnement: Gérard Rouy et Paul Haines (avec
ses Darker Ragas) donnent deux textes impeccables illustres
par photo et dessin que complète une pochette splendidement
évocatrice ! Quant à la prise de son, elle restitue
parfaitement les mouvements de lave et trajectoires de scories.
Vraiment, de haut en bas et de part en part, un travail d'artistes
très soigné et déjà plus que précieux
: nécessaire a tous égards !
Guillaume
Darkragshe (Tarche)
l ImproJazz
l Octobre
2000
|
2.gif) |
reviews |
|
|
His
duo with tenor saxophonist Evan Parker, is as gorgeous as St.
Elmo's Fire dancing around a radar mast. Rowe generates an ultradetailed,
multi-layered sound field that rises and recedes around Parker's
voluptuous, twisting shapes like short-wave-radio static from
a distant statlon's signal.
Bill Meyer
l Magnet
l April
2001
If that threatens to wash him up on the treacherous sandbanks
of nostalgie, his collaboration with Evan Parker on Dark Rags
pushes back into deep water towards the far edges of the world.
Like Rowe, Parker could be perceived to have been doing the same
thing' for some decades with his saxophones, reeds, breath and
finger dexterity. Humans tend to function in that way, moving
towards inertie, growing less innovative, less physically mobile
as they grow wiser and more individuated (as Jung would have said).
Through its emphasis on the fluidity of seflings a fracturing
of expectation, the endless possibilities of complexity generated
by combining unpredictable materials, improvisation goes some
way to addressing this otherwise miserable paradox of human existence.
Dark
Rags is heartening for being so astonishingly rich in its
formulations and psychic power, yet still true to the course set
so distantly back in the 20th century. Psychic power; did I say
that? Not a document for The X-Files, rather an illustration
of the way in which subsets of human-ness such as emotion, intellect,
instinct, psychosomatic, psychological, spiritual and chemical
are more useful to bad doctors than music critics. There are passing
suggestions of Indian classical music, both in the inventions
of a soloist against a complex drone (which doesn't begin to describe
the fluctuations of this musical relabonship) and in the allusions
of the album's titre, but also in the depth of these explorations.
Feverish and magical, Rowe fires coarse animal bellows, industriel
engineering, death rattles, dream dialogues and sine moans at
the lashing, twisting Anime plant monster that Parker unleashes.
This is a mischievous dialogue too. Aware of Parker's naturel
tendency to build upon what he hears, Rowe feeds him " Strangers
In The Night ". When Rowe pulls back from an intense assault,
leaving only a shivering metallic micro-dance in motion, Parker
sidles out of hushed ruminations into the barest hint of "
Fascinating Rhythm ". For the record, virtually nothing else
from the Jazz Monthly of 1965 has survived.
David Toop
l The Wire
l December 2000
Headlines: The two giants, Evan Parker and Keith Rowe, of British improvisation over the past 35 years, finally get together for this historic duo recording. Rowe, a founding member of AMM along with Eddie Prevost in 1965, has taken the concept of the guitar as an instrument to the most abstract degree. He plays with the guitar on a flat surface, treating it as an electric processor, utilizing feedback and finessed noises for effect. His constructions are at the expense of a deconstructive guitar. Evan Parker was/is a descendant of John Coltrane's musical logic. He took up where Expression leaves off. Parker was a member of The Spontaneous Music Ensemble, the Music Improvisation Company with Derek Bailey, Alexander von Schlippenbach's bands and Peter Brotzmann's famous Machine Gun session. He has also been recognized for his circular breathing and extended techniques in solo concert, duos with either Bailey or drummer Paul Lytton, and trios adding Barry Guy. Parker's discography rivals that of any working creative music today. But what is significant, is the many sides to his playing, from the furious solo flights to his relatively (for him) subdued Electro-Acoustic Ensemble.
Recorded live as 1999 became 2000 at Pannonica in Nantes, France the duet maintains the subtlest free improvisations I've ever heard. The two parts act as ragas or 'rags,' the Indian meditation music. Rowe's use of almost ambient noise and circulating guitar loops lay out a calmness over the proceeding, and Parker acts accordingly, playing free but without disturbing the soul. Bits of gray noise float in, I hear a radio searching for a station, all the while Parker (on tenor throughout) keeps the peace.
It is easy to be lulled into this music, but don't mistake their relative pacific nature for anything less than complex improvisations. Parker and Rowe have honed their craft over these many years to be in full control over this message. In the relative quiet there is fury. Sometimes an opinion can be best expressed when said in a whisper.
Mark Corroto l All About Jazz l December 2000
Evan
Parker is, of course, ever productive, his inventiveness and breath
seemingly in infinite supply. Keith Rowe, far more active outside
of AMM than he has been in ages, appears to be enjoying a creative
renaissance. Twin pillars of European Free Improvisation, and
infrequent collaborators by way of Supersession, Parker and Rowe
have been overdue for a summit. Just such a meeting played out
on the cusp of the Millennium, in separate concerts staged in
Nantes, France on 12-31-99 and 1-1-2000. An originator and champion
of prepared-guitar and horizontal ("table-top") guitar techniques,
Rowe is a formidable foil for Parker's expressive tenor aerobatics.
As "Dark Rag #1" opens, the musicians share anxious space within
a time-suspended vacuum of tone. The kinetic potential here is
clearly enormous. Like sprinters stealing hungry glances at the
starting line, Parker and Rowe exchange gestures-a fretboard creak,
a trill pregnant with anticipation-and take off. Though at first
as patient as Parker is euphoric, Rowe responds to the saxophonist's
hyperbolic flights in turn. While Rowe scrapes, strokes, and scours
strings to spur Parker's impassioned response, electronic treatments
broaden the attack, acting upon deliquescent drones and rhythms
like a solvent wash. During quieter sections, Rowe's short-wave
radio asserts itself, and Parker plays as if to commune with the
murmur of indiscernible voices. At the climax, Rowe engages Parker
with quicksilver trickles of electro-acoustic guitar tone, challenging
the saxophonist--a bundle of nervous energy throughout--to match
this magmatic flow. Parker obliges, but only briefly. He breaks
the moment of mutual reflection with a spectacularly elaborate
solo. Rowe's guitar responds to Parker's pointed provocation with
irascible growls, maintaining a pricklier, almost quarrelsome
presence through the remainder of the performance. Whether it's
amiable argy-bargy or genuine tension, such antagonism heightens
Dark Rags' appeal. It also leaves one wondering whether "Dark
Rag #2," which opens in groggy dissonance, is the product of the
ultimate New Year's Day drinking binge or the fallout from the
first set's spat. Rowe needles Parker with shrill pitches; the
saxophonist's slurred retort sounds queasy. Cartoonishly vivid
bass-bulge and dry, heaving noises give away the joke. It's a
hangover, improvised in nauseating Technicolour. Cute. A skittering,
jazz-skewed Parker salvo signals the return to serious improv.
Rowe pursues a more turbulent tack, providing an inconstant anchor
that shifts and groans beneath Parker's blustery phrases. After
much lurching and pitching, the harrowing section subsides. Parker
plays the passing of the storm in spacious measures, exhibiting
a rare vulnerability. Approaching the halfway mark of the 40:25
piece, Rowe tapers off the guitar noise to lulling near-nothingness,
leaving a foreign short-wave song to underscore the saxophone.
As Parker's solo continues, Rowe conceives a backdrop of metallic
shimmers and eerie echoes. The two soundstreams merge beautifully,
sustaining the sensitive interplay of these two superb musicians,
while carrying the disc to its riveting conclusion.
Gil
Gershman l
Fakejazz.com
l December 2000
|
|
|
|